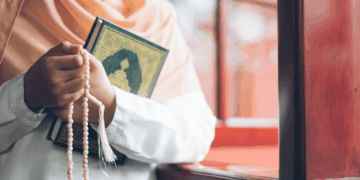Depuis l’attaque meurtrière perpétrée dans la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard, qui a coûté la vie à Aboubakar Cissé, 22 ans, Emmanuel Macron est monté au créneau pour défendre la liberté religieuse en France. L’agression, commise début avril par un jeune Français de 21 ans, qui a filmé la scène tout en proférant des insultes antimusulmanes, a été unanimement qualifiée d’acte islamophobe par les autorités, dont le Premier ministre François Bayrou ; le président de la République a pour sa part déclaré que « la haine religieuse n’a pas sa place en France ».
Le contexte de cette prise de position est lourd : la victime, originaire du Mali et fidèle de la mosquée locale, venait d’achever le nettoyage des lieux de culte lorsqu’elle a été attaquée à l’arme blanche. Le suspect, Olivier A., a ensuite pris la fuite avant d’être interpellé en Italie, trois jours plus tard, soulignant la rapidité et l’ampleur de la traque menée par les forces de l’ordre françaises et italiennes. L’enquête, d’abord envisagée hors du cadre antiterroriste, a néanmoins pris une tournure judiciaire sous l’angle de la haine religieuse, tandis que plus d’un millier de personnes ont rendu hommage à Aboubakar lors d’une marche silencieuse à La Grand‑Combe et que des manifestations contre l’islamophobie ont eu lieu à Paris et dans plusieurs autres villes.
Face à cette montée des violences ciblant la communauté musulmane, Emmanuel Macron a réaffirmé, lors d’une déclaration solennelle, que « le racisme et la haine fondés sur la religion ne sauraient trouver refuge en France ». Il a souligné que les principes de laïcité, piliers de la République, ne sauraient servir de prétexte à la stigmatisation d’une croyance : « La France n’est pas, n’a jamais été, et ne sera jamais un lieu où la liberté de culte est remise en cause », a-t-il insisté.
Cette insistance sur la laïcité renvoie à l’histoire de la séparation de l’Église et de l’État, instaurée en 1905, qui garantit à chaque citoyen la possibilité de pratiquer sa religion dans l’espace privé et public, qu’il soit chrétien, musulman, juif ou athée. Mais la montée des actes islamophobes — qu’il s’agisse de tags, d’insultes, d’agressions ou de discours politiques — ces derniers mois a conduit de nombreux observateurs à parler d’une « normalisation » de l’islamophobie, un phénomène que le chef de l’État s’est engagé à combattre avec fermeté.
Sur le plan politique, cette prise de position survient alors que plusieurs responsables de la majorité et de l’opposition envisagent de renforcer certains cadres législatifs pour lutter contre les discriminations religieuses. La possibilité d’étendre la qualification d’« infraction haineuse » à l’ensemble des atteintes aux lieux de culte et d’augmenter les moyens alloués à la protection des édifices religieux a été évoquée à l’Assemblée nationale. De son côté, l’Intérieur a déjà annoncé un plan de sécurisation des lieux de culte musulmans, avec une présence policière accrue lors des grandes célébrations, et une amélioration des dispositifs de signalement en ligne pour les victimes et les témoins.
Parallèlement, des voix venues de la société civile islamique ont réclamé des mesures plus structurelles : un renforcement de l’éducation à la tolérance dès le plus jeune âge, une meilleure formation des agents publics face aux discriminations et une évaluation chiffrée des actes islamophobes à l’échelle nationale. Le Conseil français du culte musulman, tout comme plusieurs associations antiracistes, ont salué la position du président, tout en appelant à ne pas limiter la réponse à des effets de communication, mais à engager un véritable processus de lutte contre les préjugés et la stigmatisation.
Au niveau européen, la France compte parmi les pays qui recensent le plus grand nombre d’actes islamophobes, avec près de 1 500 faits signalés en 2024 selon l’Union des organisations islamiques de France. Face à ce constat, Paris espère fédérer une initiative communautaire pour établir un baromètre commun des discriminations religieuses et promouvoir une directive visant à protéger plus efficacement les lieux de culte sur tout le continent.
La fermeté affichée d’Emmanuel Macron illustre une volonté de réaffirmer les fondamentaux de la République laïque, tout en répondant à l’urgence de protéger une minorité mise sous pression. Seule l’addition de ressources juridiques, éducatives et sécuritaires permettra, selon le président, de « garantir la liberté religieuse pour chacun et de combattre la banalisation de la haine ». Le défi reste, toutefois, de transformer ces mots en actions durables, au-delà de la résonance médiatique des déclarations présidentielles.