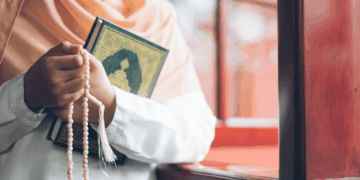Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, une minorité spirituelle fait l’objet d’une oppression discrète, constante et souvent invisible aux regards extérieurs : la communauté baha’íe. Née au XIXᵉ siècle en Perse, cette foi prônant l’unité des religions, l’égalité entre les hommes et les femmes et la paix mondiale est aujourd’hui l’objet d’une hostilité farouche dans plusieurs États à majorité musulmane. Alors même que les baha’ís refusent toute violence, qu’ils n’ont ni clergé ni ambition politique, ils sont désignés comme étrangers, déviants, ou ennemis de l’ordre religieux établi. Un paradoxe qui illustre la manière dont la spiritualité, dès lors qu’elle échappe au contrôle des pouvoirs, devient suspecte, voire dangereuse.
Une foi née en Perse et bannie de sa terre natale
Le baha’isme a vu le jour en 1844 à Shiraz, dans l’actuel Iran, à travers la proclamation d’un jeune marchand, le Báb, bientôt suivi par son successeur Bahá’u’lláh, considéré par les croyants comme le nouveau messager de Dieu. Dès ses origines, le mouvement a été accusé d’hérésie, notamment parce qu’il venait après l’islam, rompant avec l’idée d’une clôture prophétique. La Révolution islamique de 1979 a scellé le destin de la minorité baha’íe en Iran : ses assemblées spirituelles ont été interdites, ses écoles fermées, ses propriétés confisquées, ses membres régulièrement emprisonnés, voire exécutés.
Mais la singularité de cette persécution réside dans sa continuité méthodique : elle ne connaît ni relâche ni frontière. Elle se déploie désormais au-delà de l’Iran, dans des pays où la doctrine chiite iranienne ou la logique autoritaire trouvent des terrains d’extension. Le baha’isme devient ainsi le symbole d’une foi à abattre, non pas pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’elle représente : une altérité inassimilable.
Qatar : entre tolérance affichée et répression judiciaire
Au Qatar, où vivent plusieurs centaines de baha’ís, la situation a basculé récemment. L’un des responsables spirituels de la communauté a été arrêté pour avoir publié des messages religieux sur les réseaux sociaux. Il est poursuivi pour « promotion d’une secte déviante », accusation floue mais lourde de conséquences. Cette mise en cause publique s’est accompagnée de restrictions administratives : refus de délivrance de certificats nécessaires à l’emploi, blocage de dossiers personnels, interdiction d’exercer certaines professions. Le procès, toujours en cours, est suivi avec inquiétude par les organisations de défense des droits humains. Dans un pays qui se présente comme ouvert aux religions, ce traitement soulève de sérieuses interrogations sur la réalité de la liberté de croyance.
Yémen : prison, disparition, terreur
Au Yémen, dans les zones contrôlées par les Houthis, les baha’ís sont systématiquement arrêtés, interrogés, parfois détenus au secret pendant des mois. Des dizaines d’entre eux ont été capturés ces dernières années, certains expulsés de force sans avoir pu revoir leurs familles. Accusés d’être des agents étrangers, les croyants sont souvent assimilés à des espions ou à des éléments subversifs, alors même que le baha’isme interdit toute activité partisane. Les milices houthis justifient leurs actes par une logique de « pureté religieuse » et reprennent une rhétorique forgée en Iran, où les baha’ís sont considérés comme une menace pour l’islam.
Égypte : une existence civile niée
En Égypte, la communauté baha’íe est absente des registres officiels. Depuis 1960, aucune reconnaissance légale ne lui est accordée. Les enfants ne peuvent être inscrits à l’école sans mention religieuse, les mariages ne sont pas reconnus, les décès ne donnent pas lieu à des actes civils. Les baha’ís vivent donc dans une zone grise juridique, où l’existence spirituelle se heurte à l’invisibilité administrative. Plusieurs actes de violence à leur encontre ont été signalés, allant jusqu’à l’incendie de maisons ou la profanation de lieux de sépulture.
Un système de foi sans clergé, mais avec une organisation
L’un des aspects souvent mal compris par les autorités est l’absence de clergé dans le baha’isme. Cette foi repose sur des assemblées élues, locales et nationales, et sur une lecture personnelle des textes sacrés. Il n’existe pas de figure unique à suivre, ni de sermons à délivrer. Ce modèle dérange dans des contextes où l’autorité religieuse est centralisée, souvent étatique, et où toute organisation indépendante est perçue comme une potentielle opposition.
Les baha’ís s’abstiennent de tout prosélytisme dans les pays qui l’interdisent, obéissent aux lois du pays, prônent la loyauté envers le gouvernement, tout en maintenant leur fidélité à leur foi. Et pourtant, c’est précisément cette autonomie éthique, ce refus d’entrer dans une hiérarchie religieuse ou nationale, qui les rend vulnérables.
Le poids du silence international
La situation des baha’ís n’est que rarement mise en avant dans les grands débats sur la liberté religieuse. Sans État, sans ambassade, sans appui d’une grande puissance, la communauté se défend principalement par des communiqués, des rapports et le travail d’ONG spécialisées. Quelques pays musulmans, comme la Tunisie, Bahreïn ou les Émirats arabes unis, ont toutefois montré une ouverture relative, permettant à des baha’ís d’exister sans être inquiétés, même si la reconnaissance officielle y reste rare.