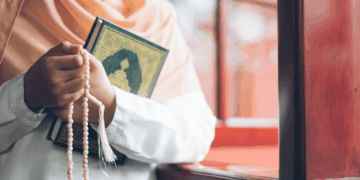Par une décision rendue le 16 juin 2025, le Tribunal civil de Florence a donné raison à l’Institut Bouddhiste Italien Soka Gakkai (IBISG) dans une affaire de diffamation intentée contre l’Associazione Italiana Vittime delle Sette (AIVS), ainsi que contre deux de ses responsables, Antonio Occhiello et Francesco Brunori. Ce jugement vient marquer un tournant dans la reconnaissance institutionnelle du bouddhisme Soka en Italie et inflige un revers cinglant aux discours stigmatisants portés par certains milieux « anti-sectes ».
L’affaire, à l’origine, porte sur une série de publications réalisées entre 2021 et 2023 par l’AIVS, sur ses réseaux sociaux et dans des médias nationaux, dans lesquelles l’organisation qualifiait la Soka Gakkai de « secte coercitive », l’accusait d’infiltrations au sein des institutions italiennes et suggérait que son accès à la répartition du 8 pour 1000 – dispositif fiscal permettant aux contribuables de financer des confessions religieuses reconnues – aurait été acquis par des manœuvres occultes impliquant notamment l’ancien président du Conseil Matteo Renzi.
Le tribunal, après avoir minutieusement examiné les pièces du dossier, a jugé ces propos diffamatoires, dénués de fondement et attentatoires à la réputation de l’organisation plaignante. Il a condamné solidairement l’AIVS, Occhiello et Brunori à verser 35 247 euros à l’IBISG au titre du préjudice moral, les a enjoint de supprimer les contenus litigieux de leur page Facebook et a ordonné la publication du jugement sur cette même page.
Une campagne délibérée de discrédit
Dans son exposé des faits, le jugement décrit une « campagne de haine et de diffamation » menée de manière récurrente contre l’IBISG. Le tribunal relève notamment l’usage réitéré du mot « secte » pour désigner la Soka Gakkai, expression jugée « offensante », en ce qu’elle véhicule une connotation péjorative de manipulation psychologique ou d’assujettissement des adeptes. Sont également considérés comme diffamatoires les propos décrivant le mouvement comme une « entité infestante », une « authentique P2 » (en référence à la loge maçonnique clandestine des années 1980), ou encore un « groupe coercitif de type mafieux ».
Le tribunal note que ces allégations ont été diffusées sans fondement vérifiable, ne reposent sur aucun élément probant, et ne peuvent dès lors bénéficier de l’excuse du droit à la critique ou à la liberté d’expression. La Cour souligne à ce propos que l’exercice du droit de critique suppose un minimum de rigueur, de véracité et de « continence formelle », ce que les publications de l’AIVS ne respectent pas. Elles excèdent le cadre d’un débat légitime pour se transformer en une attaque gratuite et systématique contre une organisation religieuse légalement reconnue.
Une reconnaissance étatique incontestable
Le jugement revient avec précision sur le processus qui a conduit à la reconnaissance officielle de l’Institut bouddhiste. L’IBISG a été doté de la personnalité juridique dès 2000, puis a entamé des négociations avec l’État italien en vue de conclure une intesa, conformément à l’article 8 de la Constitution italienne. Cette entente a été signée en 2015, et la loi de ratification (n°130/2016) a été approuvée à l’unanimité au Sénat comme à la Chambre des députés. Le rapporteur du texte, le sénateur Roberto Calderoli, y voyait un « acte absolument dû » au regard du long chemin institutionnel parcouru par l’organisation.
Le tribunal souligne que ce processus n’a rien d’inhabituel et n’a pas été imposé « par la seule volonté du Premier ministre », comme le prétendait l’AIVS. De même, il rejette l’idée selon laquelle l’IBISG aurait échappé à ses obligations de transparence : les documents fournis par la partie plaignante attestent au contraire d’une reddition de comptes régulière sur l’utilisation des fonds publics perçus via le mécanisme du 8 pour 1000.
Un avertissement aux dérives de l’anti-sectarisme
Au-delà du cas d’espèce, ce jugement met en lumière une tension persistante dans plusieurs démocraties entre la liberté d’expression – y compris celle des associations de vigilance – et le respect de la liberté religieuse, garantie par la Constitution italienne comme par la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour prend soin de distinguer l’exercice légitime du droit de critique de la propagande stigmatisante. Reprenant les standards posés par la jurisprudence de la Cour de cassation, elle rappelle que « la critique, même vive, doit rester dans les limites de la véracité des faits et de la forme correcte de leur expression ». Elle souligne également que reprendre des accusations déjà relayées par d’autres auteurs, sans vérification ni prise de distance critique, n’exonère pas de la responsabilité civile.
Le jugement rejette ainsi les arguments de la défense, qui se référait à des travaux journalistiques ou universitaires publiés à l’étranger, notamment en France et au Royaume-Uni, pour justifier son propos. Le tribunal affirme qu’il ne s’agit pas ici d’un débat d’idées, mais d’une campagne dénigrante, ciblée et répétée, en contradiction flagrante avec le statut public de l’IBISG en Italie.
Un précédent judiciaire lourd de sens
En condamnant une association qui se présente comme un acteur de la lutte contre les dérives sectaires, la justice italienne établit un précédent important. Elle réaffirme la nécessité de protéger les confessions minoritaires contre les amalgames, les soupçons sans preuve et les discours de haine.
La Soka Gakkai, présente dans plus de 190 pays et forte de près de 100 000 membres en Italie, est reconnue pour son engagement en faveur de la paix, de l’éducation et du dialogue interreligieux. La décision du Tribunal de Florence vient rappeler que, dans une société pluraliste, la légitimité d’une conviction religieuse ne peut être déterminée par le prisme idéologique d’acteurs autoproclamés, mais doit s’appuyer sur le droit, la reconnaissance institutionnelle et le respect des principes fondamentaux.
À l’heure où les accusations de dérives sectaires sont trop souvent instrumentalisées pour disqualifier des groupes religieux minoritaires, ce jugement constitue un signal fort : la liberté religieuse, comme la liberté d’expression, ne peut être invoquée à sens unique.